
Collaboration entre domaines des soins et spécialistes des addictions impliquant un service de liaison, des pairs aidants ou du travail social – Revue des bénéfices, vécus et éléments de mise en œuvre
Améliorer les collaborations entre réseau professionnel des addictions et milieu hospitalier
Le projet « Collaboration directe addiction », financé par Promotion Santé Suisse et géré par le Groupement Romand d’Études des Addictions (GREA), a pour objectif d’améliorer les interfaces entre les réseaux professionnels de prévention et de prise en charge des addictions et le milieu hospitalier. À cette fin, des projets pilotes régionaux seront réalisés et évalués entre 2024 et 2026. En parallèle, une étude en deux volets a été réalisée par Addiction Suisse. Le premier comprend un inventaire des collaborations existantes, en Suisse, entre structures hospitalières et organisations ou personnes spécialisées dans le domaine des addictions. Le deuxième est une revue de la littérature internationale et nationale visant à identifier les pratiques recommandées. Le présent rapport de recherche est dédié à ce second volet de l’étude.
Revue de littérature sur les facilitateurs et obstacles des collaborations
La revue de littérature a été effectuée sous la forme d’un « scoping review » (ou étude de la portée) centré sur trois formes possibles de collaboration interprofessionnelle dans le domaine des addictions : l’intégration de pair·e·s aidant·e·s, les équipes de liaison, et le travail social. Les principales contraintes de recherche étaient la langue (anglais, français, allemand) et l’année de publication (à partir de 1990) dans une sélection de trois banques de données (Web Of Science, PubMed et Ovid Medline). Par ailleurs, une recherche de littérature grise sur des collaborations existantes en Suisse a été effectuées les sites Internet officiels des hôpitaux cantonaux et des cantons ainsi qu’au travers du moteur de recherche Google.
En juin 2023, 5872 références ont été extraites des trois banques de données utilisées. Après exclusion des doublons, 5844 références ont été pré-sélectionnées, dont 94 ont finalement été retenues pour l’analyse. Concernant les pratiques au niveau Suisse, 57 documents ont été identifiés, dont 31 ont été retenus.
Il est à noter que de nombreuses collaborations existantes n’ont pas fait pas l’objet d’une publication, puisqu’il s’agit souvent de démarches pratiques, sans vocation de recherche. Ceci représente une limitation importante dans cette revue de littérature, dont les enseignements ne reflètent ainsi que les publications recensées puis sélectionnées en suivant la méthodologie choisie.
Pair-aidance et services de liaison : des démarches prometteuses mais exigeantes
Les pair·e·s aidant·e·s (ou praticien·ne·s, abrégés PAs)[1] sont l’objet principal de 41 publications retenues. Celles-ci traitent du rôle et de l’intégration des PAs, de la faisabilité et des avantages, de l’impact de leur intégration sur divers indicateurs de santé des patient·e·s, ainsi que des descriptions d’implémentations concrètes ou des outils et recommandations. Il en ressort que l’implication des PAs semble améliorer les résultats de santé des patient·e·s, tant en termes de consommation que de comorbidités. Leur implication favoriserait également de meilleures relations entre les patient·e·s et le personnel soignant, de même qu’une meilleure qualité de vie au travail pour ce dernier. Il est possible que cette implication apporte également des bénéfices personnels aux PAs elles·eux-mêmes, bien qu’ils·elles doivent surmonter de nombreux défis dans ce rôle.
Les différents facilitateurs et obstacles identifiés mettent en évidence certains éléments nécessaires à l’intégration réussie d’un·e pair·e aidant·e dans un service. Le mode de financement et la présentation du programme au sein de l’institution sont des étapes préalables cruciales. Ensuite, l’introduction d’un·e·pair·e aidant·e nécessite un accompagnement et une définition préalable claire des rôles de chacun·e. L’adéquation du·de la pair·e aidant·e en termes de formation, de caractéristiques, de personnalité et d’historique personnel (p.ex. type de substance consommée, expérience carcérale, troubles associés) avec les exigences du rôle est essentielle. La formation préalable du·de la pair·e aidant·e et du personnel en place facilite leur intégration. Enfin, une supervision doit être mise en place.
Les services de liaison en addictologie sont des équipes mobiles, qui ont pour tâches principales de former et assister les équipes soignantes, intervenir auprès des personnes ayant des troubles de type addictif et élaborer des protocoles de soins et de prise en charge ; ces équipes apportent ainsi un soutien également en termes de problématiques somatiques. Au total, 43 publications retenues se réfèrent principalement à un service de liaison. Les publications traitent des impacts sur les patient·e·s et en particulier leur santé, ainsi que de l’impact sur les coûts de la prise en charge. Elles thématisent égalementles difficultés des soignant·e·s au sein des équipes de liaison, l’intérêt de disposer de telles équipes, les avis des équipes soignant·e·s, des rôles et compositions des équipes de liaison ainsi que de l’implémentation et de l’audit de telles équipes.
L’introduction d’équipes de liaison semble avoir des effets positifs sur les résultats des patient·e·s concernant la dépendance à l’alcool, et sur les mesures relatives à la gestion de ce trouble (mais pas sur l’abstinence). D’autres bénéfices seraient que les services de liaison peuvent diminuer les coûts de la prise en charge, situer l’addiction en tant que maladie au sein de l’hôpital, proposer du soutien aux équipes et élaborer des protocoles de traitement pour la prise en charge médicamenteuse du trouble d’une part, et pour la gestion de la douleur d’autre part.
Pour l’établissement d’un service de liaison, les facteurs essentiels relevés sont son intégration dans les structures préétablies de l’hôpital ainsi que la communication sur l’existence même du service, ses apports et les processus pour y recourir. La collaboration avec les structures externes à l’hôpital doit également être priorisée et préparée. Ensuite, dans le contexte de la prise en charge, ces équipes doivent offrir une expertise relationnelle et somatique. Leur succès tient au fait d’intégrer des approches de prévention, d’évaluation et d’intervention (y compris pharmacologique) fondées sur des preuves et standardisées. L’évaluation continue et le suivi de l’implémentation du service de liaison permettent de détecter et de résoudre les difficultés assez tôt.
Concernant les services sociaux, seulement cinq publications retenues traitent principalement de ce type de collaboration. En effet, bien que les services sociaux soient très fréquemment intégrés dans des services de liaison, peu d’articles traitent explicitement du rôle, des avantages et des difficultés de ces services. Dans les articles retenus à leur sujet, leur capacité à mener des entretiens motivationnels est relevé.
D’une manière générale, la formation facilite la collaboration interprofessionnelle et permet d’améliorer la prise en charge. Cinq articles retenus traitent essentiellement des résultats de formations en ligne et de leurs avantages. Les formations présentées sont évaluées positivement par les participant·e·s, qui se sentent plus à même de gérer des cas complexes suite à la formation. Toutefois, la seule étude qui a tenté d’évaluer l’impact sur les traitements utilisés, n’en a pas relevé.
Une vision encore parcellaire des initiatives en Suisse
La littérature grise relative à des initiatives en Suisse contient uniquement des exemples de collaborations sous forme d’équipe de liaison ou de formations. Cette image reste toutefois très partielle, car beaucoup de collaborations ne font pas l’objet d’une documentation publiquement accessible.
Quant aux possibilités de financement, une étude relève un manque dans les possibilités de rémunérer des tâches de coordination pourtant essentielles pour une bonne collaboration interprofessionnelle
En conclusion
La revue de littérature suggère que la pair-aidance et les services de liaison peuvent améliorer non seulement la prise en charge des patient·e·s et leur santé, mais aussi la satisfaction au travail du personnel soignant et une réduire des coûts par le biais de la prise en charge interprofessionnelle.
Les freins et facilitateurs relevés se situent à différents niveaux. Au niveau systémique, afin de créer un contexte favorable pour la collaboration interprofessionnelle, le développement d’un mécanisme de financement adapté est essentiel. L’essentiel des recommandations se situe toutefois au niveau institutionnel, à commencer par la définition claire des rôles et des cahiers des charges, la mise en œuvre de formations et un soutien, y compris administratif, afin de surmonter les résistances individuelles et les problématiques interpersonnelles qui peuvent freiner ces initiatives.
[1] La définition retenue pour cette revue est celle proposée par l’association Re-pairs (2021): « Un pair praticien en santé mentale (PPSM) est un professionnel de la santé qui a souffert d’un trouble psychique ou d’une addiction. Après avoir progressé sur la voie du rétablissement et pris assez de recul sur son vécu, il a accompli une formation certifiante afin de soutenir le rétablissement d’autres personnes. Il a ainsi un rôle d’expert par expérience.».







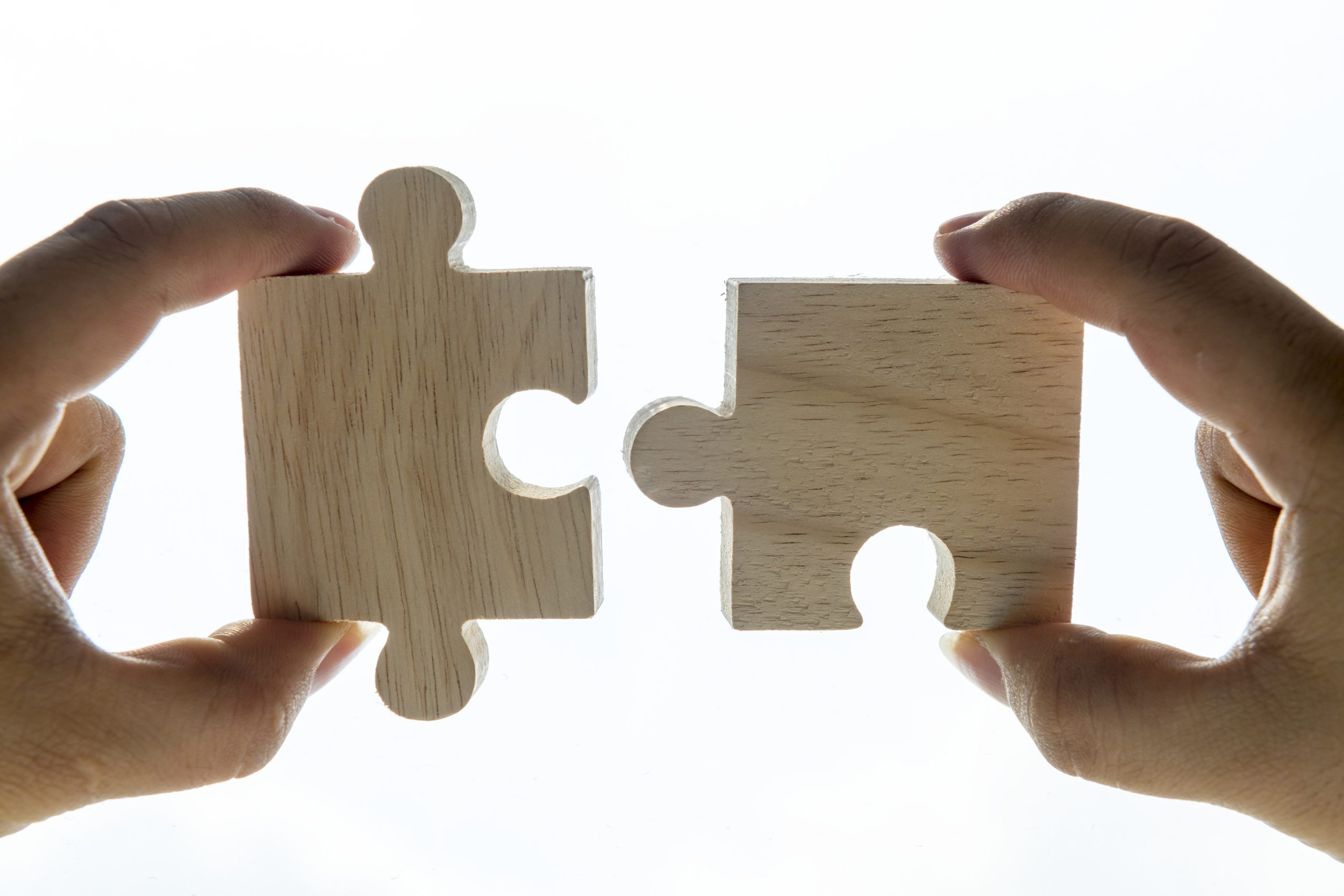
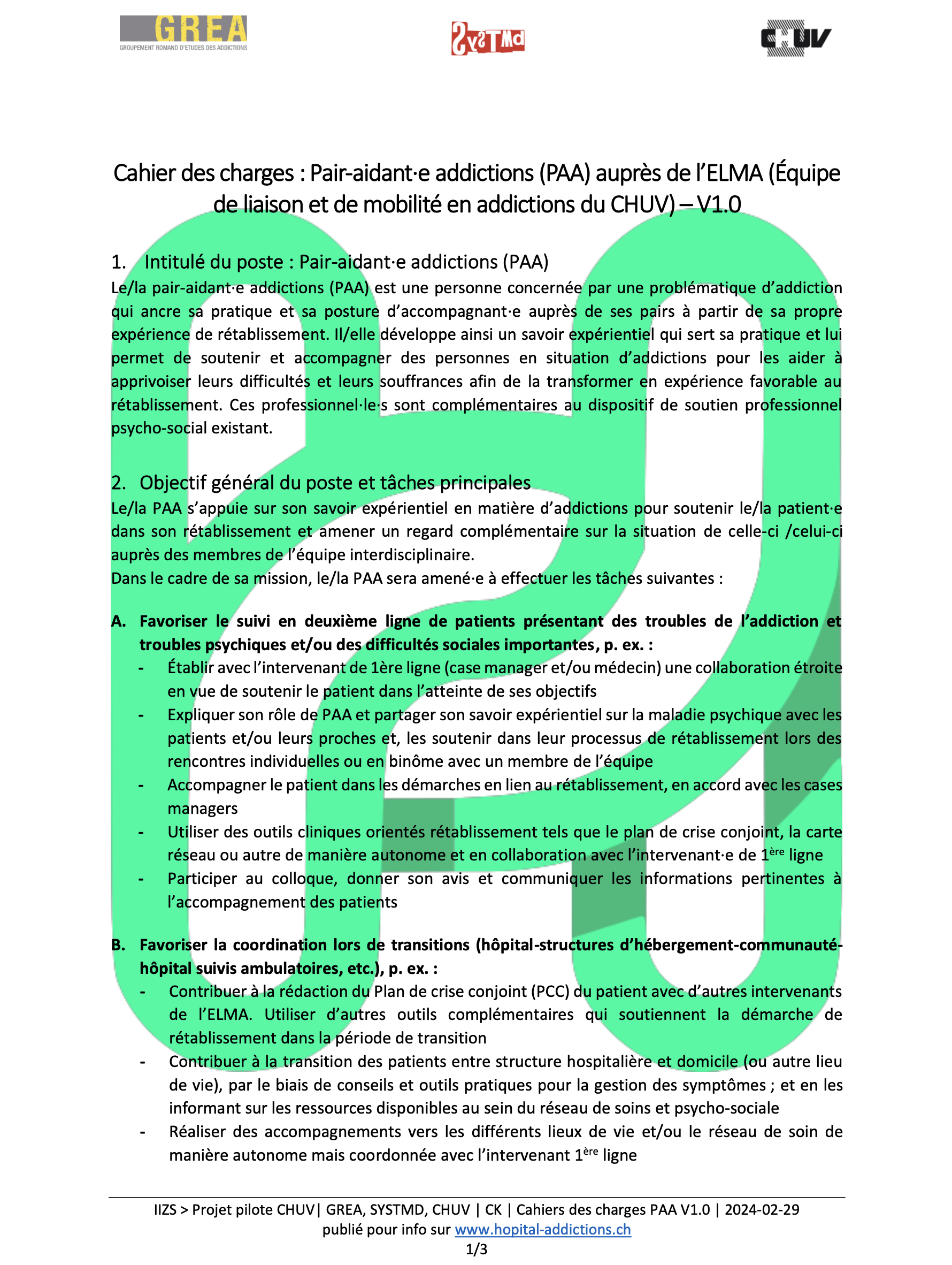

Hôpital et Addictions
Sucht im Spital
Hospital and addiction
C/O Groupement Romand d’Etude des Addictions (GREA)
Rue Saint-Pierre 3
CH-1003 Lausanne
+41 (0) 24 426 34 34
info@hopital-addictions.ch
Impressum
Droits d’utilisation

Le site web hopital-addictions.ch a été conçu et réalisé par le GREA.
Cyrus Brüggimann s’est chargé du design et de la réalisation technique de la première version du site (version actuelle).
Sa maintenance et les développements ultérieurs seront assurés par FFLOW Agency Lausanne.
Les images utilisées sur ce site proviennent de Freepik. Les portraits des collaborateurs ont été repris des sites web de leur institution respective.
L’ensemble du matériel produit dans le cadre du projet Hôpital et Addictions, mis à disposition sous la rubrique « ressources », est soumis à une License Creative Commons de type CC BY-NC.
Cette licence permet aux ré-utilisateurs de distribuer, remixer, adapter et développer le matériel sur n’importe quel support ou format à des fins non commerciales uniquement, et seulement à condition que l’attribution soit donnée au créateur.